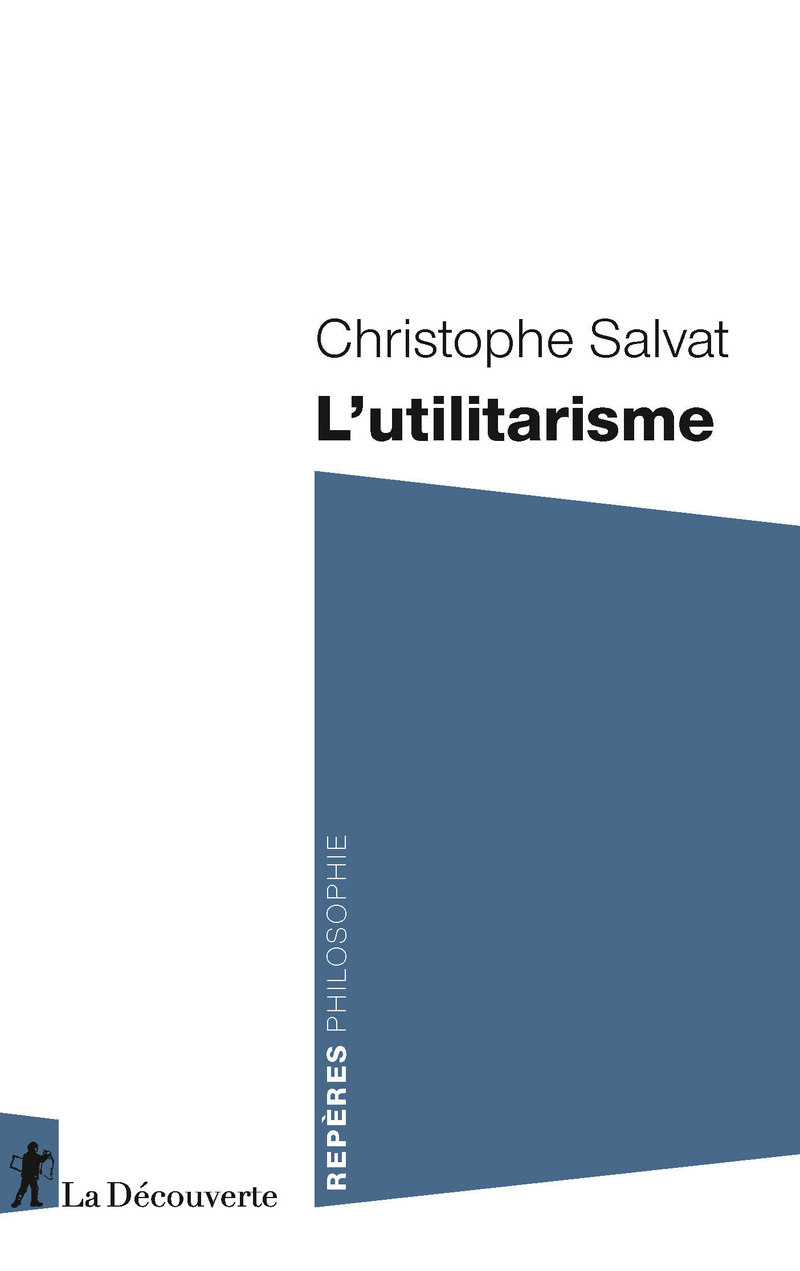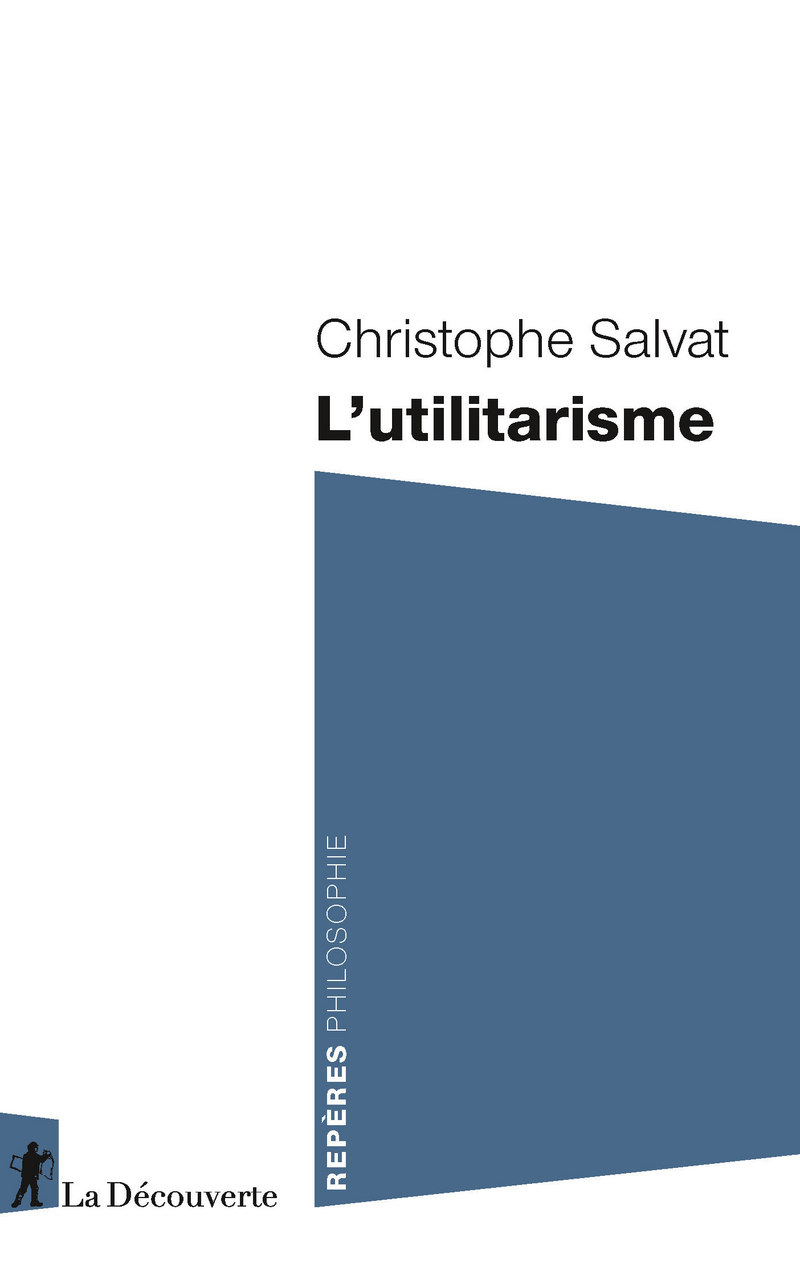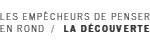L'utilitarisme
Christophe Salvat
L'utilitarisme est un mouvement philosophique aussi important que mal connu en France. Né au XVIIIe siècle en Angleterre avec Jeremy Bentham (1748-1832), il constitue aujourd'hui l'un des principaux courants de l'éthique normative et a des prolongements importants en sciences économiques et de gestion, en droit et en science politique. Une bonne connaissance de l'utilitarisme est également indispensable à tous ceux qui s'intéressent aux grands enjeux éthiques de notre société. L'objet de cet ouvrage est de présenter les fondements historiques de l'utilitarisme, les difficultés qu'il soulève, mais aussi ses développements contemporains. Il est structuré autour de quatre grands thèmes : l'utilitarisme classique, la mesure et la maximisation de l'utilité, l'utilitarisme de la règle ou de l'acte, et, enfin, le principe de l'impartialité. Familiarisé avec les outils conceptuels de l'utilitarisme, le lecteur est alors invité à s'interroger sur de grands enjeux éthiques de notre société, tels que la pauvreté dans le monde, la souffrance animale et le réchauffement climatique.

 Christophe Salvat
Christophe Salvat

Table des matières 

Introduction
Qu'est‑ce que l'utilitarisme ?
Les raisons d'un discrédit
Pourquoi s'intéresser à l'utilitarisme aujourd'hui ?
Objet et plan de l'ouvrage
I / L'utilitarisme classique
Bentham et le radicalisme philosophique
Jeremy Bentham (1748-1832), le philosophe réformateur - Le principe d'utilité - Le calcul de félicité
L'utilitarisme libéral de John Stuart Mill
John Stuart Mill (1806-1873), figure intellectuelle du XIXe siècle - L'hédonisme qualitatif de Mill - L'utilitarisme libéral de Mill
Les Méthodes de l'éthique d'Henry Sidgwick
Henry Sidgwick (1838-1900), le professeur de Cambridge - Les trois méthodes de l'éthique - Le dualisme de la raison pratique
Conclusion
II / Mesurer, agréger et maximiser l'utilité
Les trois conceptions du bien‑être
La théorie des états mentaux - La théorie du succès et l'utilitarisme des préférences - La théorie des listes objectives
L'utilité comme mesure du bien
Théories cardinales et ordinales de l'utilité
Utilité totale ou utilité moyenne ?
Questions relatives à la maximisation d'utilité
Sur quel horizon temporel maximiser l'utilité ? - L'utilitarisme négatif - Doit-on absolument maximiser l'utilité ?
Conclusion
III / L'utilitarisme de la règle
De l'utilitarisme de l'acte à l'utilitarisme de la règle
Qu'est-ce que l'utilitarisme de la règle ?
Principaux modèles de l'utilitarisme de la règle
L'utilitarisme à deux niveaux de Hare - Le code moral idéal - Utilitarisme de la règle et contractualisme
Avantages et limites de l'utilitarisme de la règle
L'utilitarisme de la règle face aux objections faites à l'utilitarisme classique - Limites de l'utilitarisme de la règle - Au-delà de l'utilitarisme de la règle
Conclusion
IV / Impartialité : théorie et pratique
Le principe d'impartialité
Impartialité, universalité et égalité - Impartialité et maximisation d'utilité - Impartialité et égalité
Limites du principe d'impartialité
De l'impartialité à l'impersonnalisme - Prendre les droits des personnes au sérieux - L'utilitarisme est-il vraiment égalitaire ?
(Ré)intégrer la notion de personne
(Ré)concilier utilité et droits - Le prioritarisme - Existe-t-il des prérogatives personnelles en morale ?
L'impartialité en pratique : l'utilitarisme face à l'éthique appliquée
Les famines et la grande pauvreté - L'éthique animale - L'éthique environnementale
Conclusion
Repères bibliographiques.