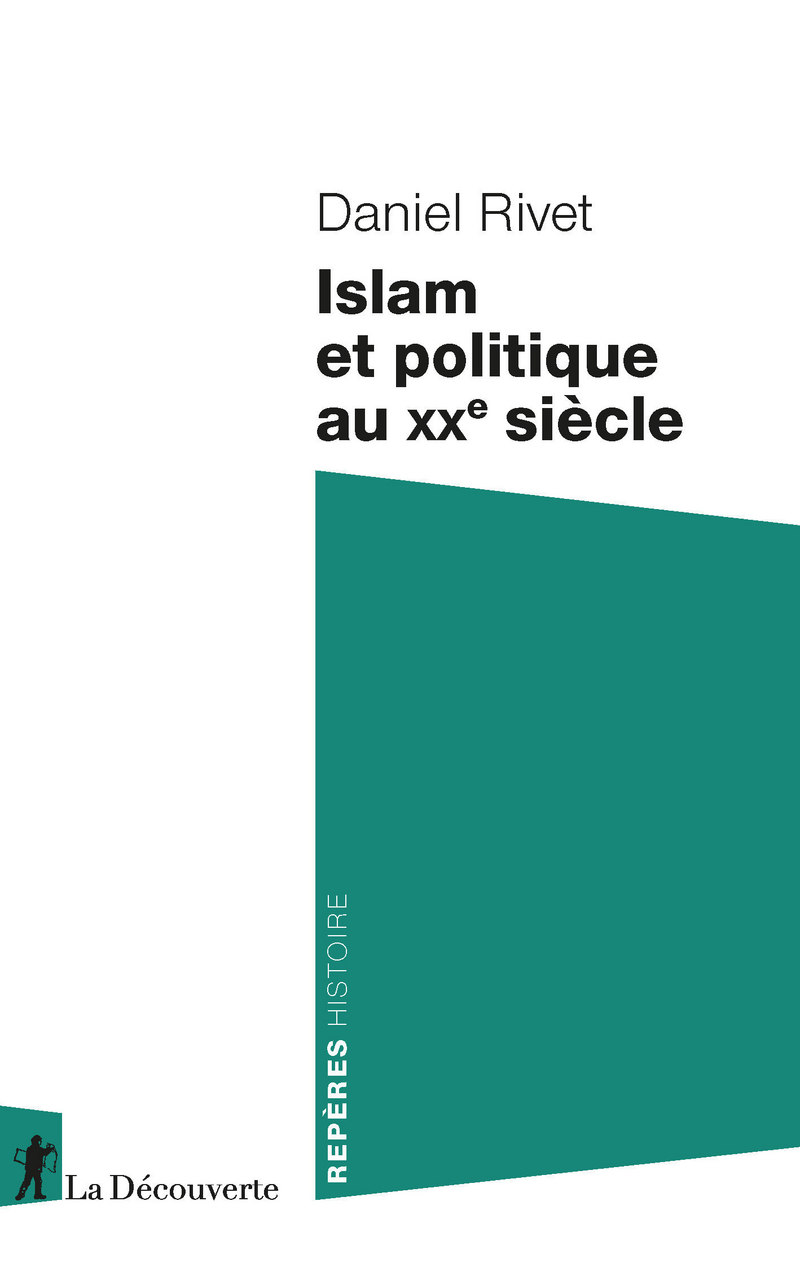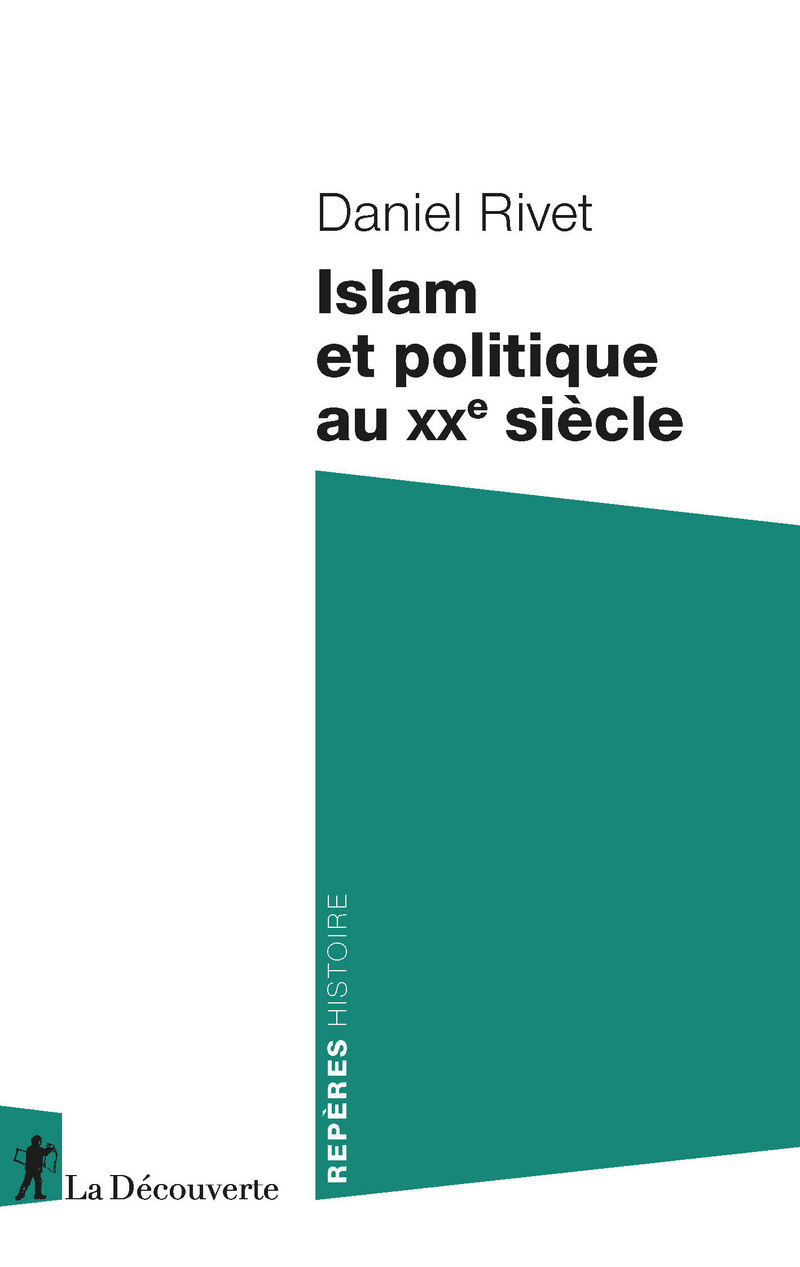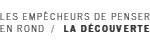Islam et politique au XXe siècle
Daniel Rivet
De Java au Maroc, l'art de faire politique a longtemps été en tension avec le religieux, et non en fusion. L'irruption de l'Europe dans les mondes musulmans, au XIXe siècle, a déclenché des modernisations défensives qui, mettant le religieux entre parenthèses, se sont aliéné les peuples. Après la suppression du califat ottoman par Mustapha Kemal en 1924, des expériences de démocratisation se sont déroulées de l'Égypte à l'Indonésie. Hormis dans la Turquie postk émaliste, elles ont été étouffées par l'installation de républiques césariennes et populistes. Et la recherche d'un équilibre entre croyants et citoyens a été suspendue.
L'islam politique est monté en puissance au cours des années 1970-1980, mais il a échoué à prendre le pouvoir, sauf en Iran et au Soudan. Lui a succédé la vague du salafisme, qui oscillait entre l'imposition à la société d'un ordre moral islamique et un régime de terreur, dont Daech a été le paroxysme. Mais, si la fin du XXe siècle a été marquée par le retour de Dieu, notre époque pourrait bien être celle de la résurgence des peuples, depuis les Printemps arabes de 2011.

 Daniel Rivet
Daniel Rivet

Table des matières 

Introduction / Islam et politique, un couple non pas en fusion, mais sous tension
I. L'islam au défi de la colonisation : fin du XIXe siècle-milieu du XXe siècle
Les essais de modernisation défensive contre l'Occident
Premiers contacts et formation d'un milieu réformiste tourné vers l'Europe
Des réformes séculières autoritaires menées sans le concours des peuples
Courant libéral-constitutionnel et réformistes musulmans
De la suppression du califat en 1924 à la fin des années 1950 : les musulmans orphelins d'un père légitime
L'onde de choc de la Première Guerre mondiale
Le grand débat en 1924‑1925 sur le califat en Égypte et ses contrecoups
Des querelles entre clercs aux conflits interétatiques
Controverses en Inde entre musulmans et genèse du Pakistan
Le salafisme saoudien à la remorque des Al Saoud
II. L'insuccès du politique à se séparer du religieux (1920‑1970)
Quand l'islam devient la religion de l'État et un culte civique
Mustapha Kemal en Turquie (1923‑1938) et Reza Shah en Iran (1921‑1941)
Habib Bourguiba en Tunisie (1956‑1987)
Quand les promesses d'une démocratie musulmane sont interrompues
En Indonésie, le parti Masjumi en quête d'un " État religieux démocrate " (1945‑1960)
En Turquie, une alternative au kémalisme : le Parti démocrate d'Adnan Menderes (1950‑1960)
Quand l'affrontement entre l'entité confessionnelle et le nationalisme laïc reste incertain
Mohammed Mossadegh en Iran : nationalisme laïc et mise en branle des religieux (1951‑1953)
Dynamisme du nationalisme arabe et prégnance du confessionnalisme
III. L'irruption fracassante de l'islamisme dans les années 1980
Le background
: l'avènement d'une mouvance islamiste
La première génération d'après l'indépendance : ses caractéristiques
Une militance de type nouveau qui s'empare de l'islam comme d'une idéologie
Les maîtres à penser de l'islam politique
Jihad : l'écart entre ce que disent les textes sacrés et ce que prêchent les islamistes
Flux et reflux de la révolution islamique
L'ancrage de la révolution islamique en Iran et son éclipse au Soudan
Ailleurs : la lente décrue des islamistes
IV. Les années 1990 : le glissement dans le néofondamentalisme, l'islamo-nationalisme et le terrorisme
Comment et pourquoi l'islamisme reflue après 1990
La perte d'emprise sur les gens
La résilience des États autoritaires
L'inondation du croire néofondamentaliste
L'accommodation à l'individuation des croyances
Deux vecteurs de diffusion : l'écrit piétiste et les nouveaux prédicateurs
L'émergence des islamo-nationalistes
L'effort d'actualisation des penseurs islamistes
L'essor des partis islamistes nationaux
L'extrémisme islamique
Des guerres civiles en Afghanistan et en Algérie à la nébuleuse transnationale d'Al-Qaïda
Encadré. Les talibans
Un commun dénominateur : le culte des martyrs
Un point d'appui à la diffusion de la koinè salafiste : l'Arabie saoudite
Conclusion
Repères bibliographiques.