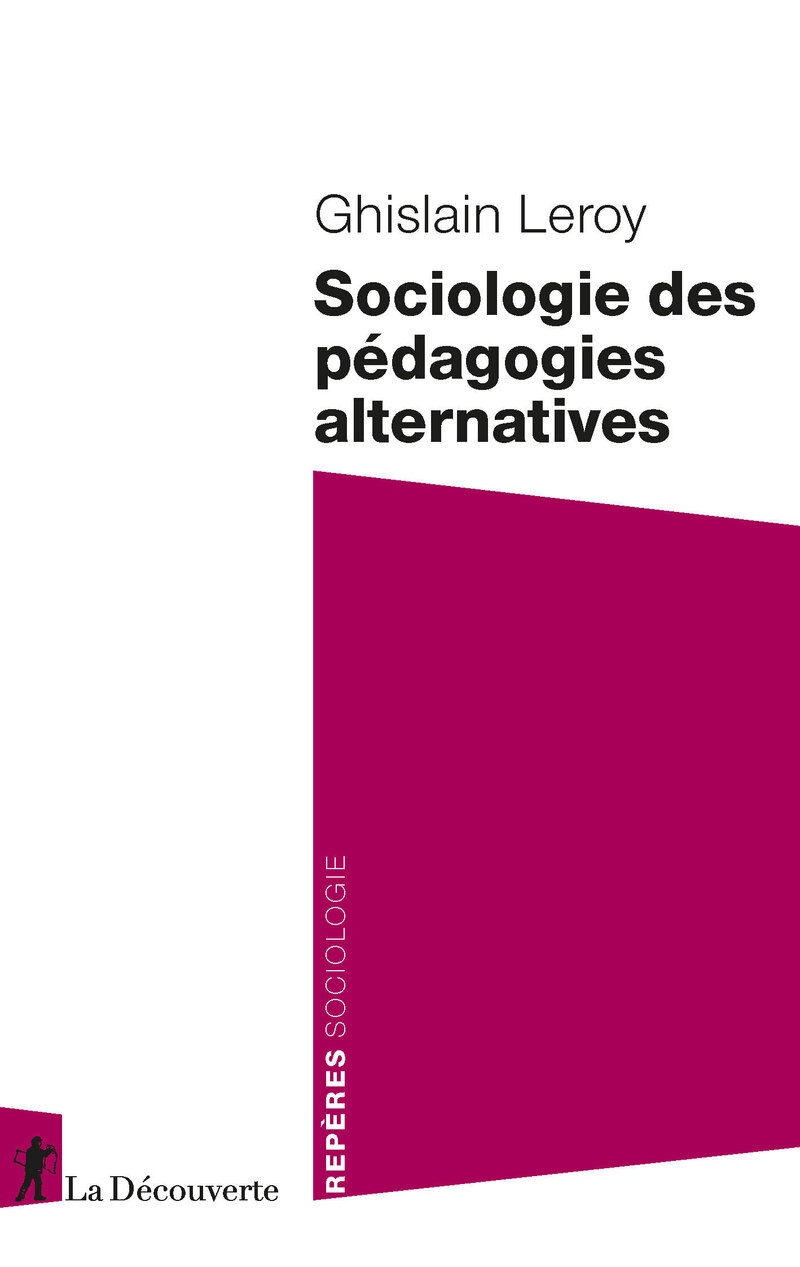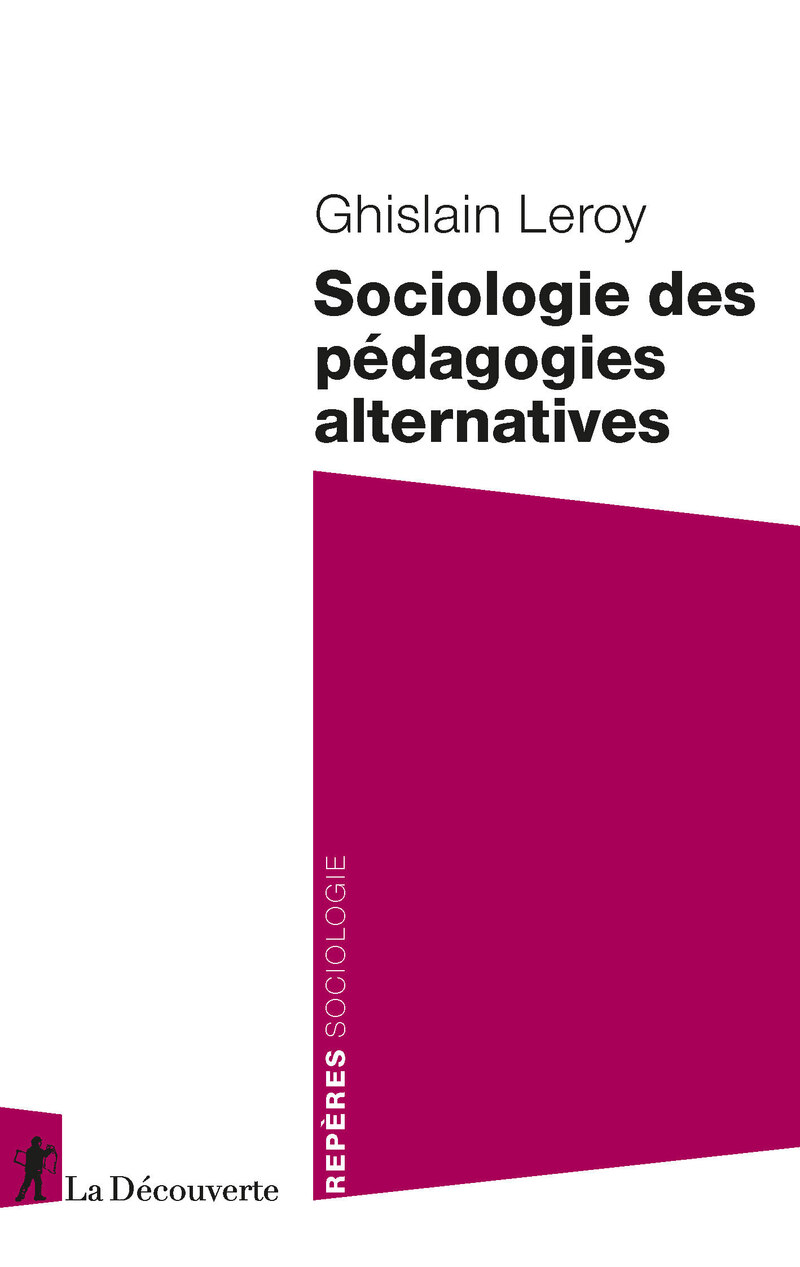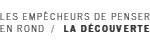Sociologie des pédagogies alternatives
Ghislain Leroy
Les analyses sociologiques des pédagogies alternatives sont rares. Or le paysage pédagogique contemporain est celui de l'émergence ou de la résurgence d'alternatives : pédagogies néo-Montessori, écoles démocratiques, Steiner, instruction en famille, etc. Quel est l'état des savoirs sur ces nouvelles pratiques ? Comment les penser dans un monde où les valeurs néolibérales gagnent du terrain ? Quelles pédagogies paraissent aujourd'hui " rationnelles ", c'est-à-dire capables de réduire les inégalités sociales en expansion ? Quelle place les pédagogies critiques peuvent-elles tenir dans ce paysage, si leur but est de subvertir les dominations de classe, de genre, de race ou de sensibiliser aux enjeux environnementaux ? L'objectif de cet ouvrage est de replacer les pédagogies nouvelles, ou alternatives, dans la réalité des mondes sociaux actuels et passés. Il présente leur histoire, leurs acteurs, leurs méthodes et s'interroge sur leur capacité à faire réussir les moins bien dotés par leur milieu d'origine.

 Ghislain Leroy
Ghislain Leroy

Table des matières 

Introduction
I. Définir et penser l'" éducation nouvelle " au regard des sciences humaines
Les pédagogues de l'" éducation nouvelle ", unité et diversité
Contre l'éducation " traditionnelle ", fonder une autre pédagogie
Encadré :
Célestin Freinet (1896‑1966)
Les différentes théories pédagogiques dans le courant de l'éducation nouvelle
Encadré :
Quelques figures de l'éducation nouvelle
Encadré :
Maria Montessori (1870‑1952)
Encadré :
Alexander Sutherland Neill (1883‑1973) et l'expérience de Summerhill
L'émergence de l'éducation nouvelle, pensée au regard des sciences humaines
L'éducation nouvelle : accomplissement de la liberté individuelle ou de l'assujettissement ?
Éducation nouvelle et forme scolaire
L'éducation nouvelle, pour les dominés ou les dominants ?
II. Diffusion et variété des pédagogies alternatives (début XXe siècle-1980)
Légitimité et diffusion croissantes de l'éducation nouvelle dans la première moitié du XXe siècle
1910‑1939 : d'initiatives individuelles originales à une légitimité officielle
La complexité de l'étude de la diffusion
Années 1950‑1970 : entre effervescence, entrée au port et normalisation de l'" alternatif "
Éducation nouvelle et démocratisation de l'enseignement
Éducation nouvelle et climat libertaire des années 1960‑1970
Entrée au port et normalisation
III. L'alternatif en contexte néolibéral (des années 1980 à nos jours)
L'influence croissante d'une pédagogie néolibérale ?
Recherche d'efficacité, responsabilisation locale et pédagogie
La défense des valeurs conservatrices
" Innover "... mais selon certaines attentes
Autonomie de l'élève et nouvelles normes pédagogiques socioconstructivistes
Les attentes croissantes d'autonomie de l'élève
Une certaine importance pour les pédagogies socioconstructivistes
L'éducation nouvelle en contexte néolibéral
Le néolibéralisme contre l'éducation nouvelle
Encadré :
Identifier l'influence et l'ampleur des pédagogies à chaque époque : un casse-tête méthodologique
L'éducation nouvelle mise à contribution en régime néolibéral ?
Éducation nouvelle et enseignement en milieu populaire
IV. Recourir aux pédagogies alternatives pour lutter contre la difficulté scolaire ?
Des dispositifs de lutte contre la difficulté scolaire qui mobilisent les pédagogies alternatives
L'éducation prioritaire
Structures de retour à l'école
L'accompagnement à la scolarité
La sociologie, la pédagogie rationnelle, les pédagogies alternatives
La vigilance critique de la sociologie de l'éducation face aux pédagogies " invisibles "
Les sociologues à la recherche de la pédagogie rationnelle
Les pédagogies alternatives peuvent-elles être " rationnelles " ?
V. Les acteurs de l'" alternatif "
Les enseignants " alternatifs "
Sociologie des enseignants alternatifs
Formation et diffusion d'informations
Le travail de l'enseignant alternatif
Les élèves de l'alternatif
Parcours
Le ressenti des élèves de l'alternatif
VI. Les " nouvelles " alternatives (années 2020)
Montessori, en grâce
Penser le " retour " de Montessori
Le succès de Montessori, au-delà de l'école privée
Différentes écoles Montessori, pour des publics différents
D'autres écoles ou instructions " alternatives " contemporaines
Écoles Steiner-Waldorf
Les écoles Sudbury
Encadré :
La notion d'" intérêt de l'enfant " ou de spontanéité enfantine, au prisme de la sociologie de la socialisation
L'instruction en famille
Hybridations au sein du marché actuel de l'alternatif
Les pédagogies critiques
Paulo Freire, inspirateur de multiples pédagogies critiques
La pédagogie féministe
La pédagogie
queer
La pédagogie critique de la race
La pédagogie décoloniale
L'éco-pédagogie critique
Pédagogies critiques, éducation nouvelle, pédagogie rationnelle
Conclusion
Repères bibliographiques.